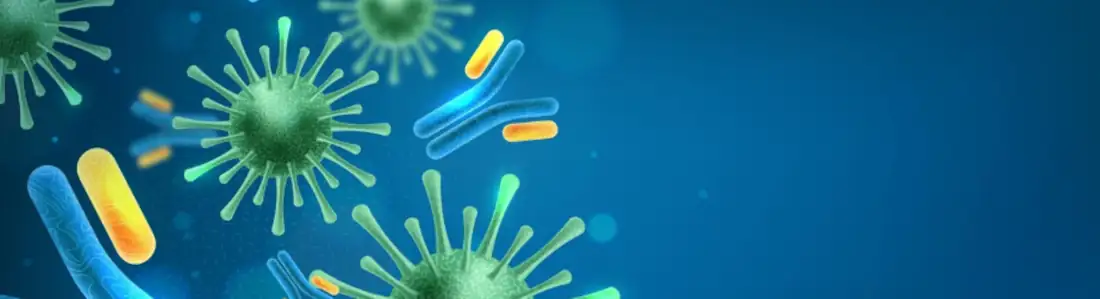Pendant longtemps, on a pensé que le vieillissement était surtout une affaire de « mécanique interne » : usure des cellules, inflammation chronique, raccourcissement des télomères… Mais une revue scientifique récente (Ageing Research Reviews, 2025) met en lumière un acteur oublié : les infections persistantes.
Des passagers à vie
Tout au long de notre existence, nous accumulons des virus, bactéries, champignons ou parasites capables de rester latents dans nos tissus ou nos nerfs pendant des années.
Parmi eux :
- Herpèsvirus (EBV, CMV, HHV-6…) – présents chez plus de 90 % des adultes.
- Bactéries chroniques comme Porphyromonas gingivalis (gencives) ou Borrelia burgdorferi (maladie de Lyme).
- Parasites comme Toxoplasma gondii.
- Champignons comme Candida albicans.
Ces « hôtes silencieux » ne restent pas inactifs : même dormants, ils produisent des protéines et métabolites qui perturbent nos cellules.
Comment ils accélèrent le vieillissement
L’étude décrit plusieurs mécanismes clés par lesquels ces pathogènes contribuent aux maladies liées à l’âge :
- Inflammaging : inflammation chronique de bas grade entretenue par les protéines et toxines microbiennes.
- Sénescence cellulaire : certains agents déclenchent l’arrêt permanent de croissance de cellules, qui deviennent elles-mêmes pro-inflammatoires.
- Détournement mitochondrial : les pathogènes utilisent nos mitochondries pour se répliquer, perturbant la production d’énergie.
- Altérations épigénétiques et raccourcissement des télomères : notamment via l’intégration virale (ex. HHV-6 dans les télomères).
- Immunosénescence : épuisement progressif des lymphocytes T, affaiblissant la défense contre de nouvelles menaces.
Maladies concernées
Les auteurs rappellent que ces infections sont liées à :
- Alzheimer et Parkinson : certaines protéines cérébrales (amyloïde-β, alpha-synucléine) agiraient comme des défenses antimicrobiennes.
- Maladies cardiovasculaires : parodontites, athérosclérose.
- Déclin cognitif : infections précoces associées à un risque accru de démence des années plus tard.
Comportements pour limiter les risques si l’on est déjà infecté
Les études convergent sur une stratégie : réduire les déclencheurs de réactivation et soutenir l’immunité.
- Sommeil régulier et suffisant : essentiel pour la réponse antivirale.
- Activité physique modérée et régulière : améliore la circulation des cellules immunitaires sans stress excessif.
- Alimentation anti-inflammatoire : riche en végétaux, fibres, oméga-3, polyphénols (thé vert, curcuma, baies, huile d’olive).
- Maintien d’un microbiome équilibré : par une bonne hygiène buccale, l’apport de probiotiques et prébiotiques.
- Vaccination ciblée : par exemple contre le zona, la grippe ou l’hépatite B selon l’âge et les risques.
- Gestion du stress : méditation, cohérence cardiaque, temps de récupération après effort.
- Éviter les excès : tabac, alcool, surmenage physique, sucres ajoutés.
Et si certaines thérapies “anti-âge” agissaient déjà sur ces infections ?
Des molécules bien connues dans la longévité pourraient avoir une partie de leur effet en limitant l’activité pathogène :
- Rapamycine (inhibe mTOR utilisé par les virus).
- Metformine (active AMPK, défavorable à la réplication virale).
- Glutathion, NAD+ (réduction du stress oxydatif exploité par les microbes).
- Plantes antimicrobiennes (griffe de chat…).
- Antiviraux ciblés : certaines cohortes montrent une réduction du risque de démence après traitement anti-herpès.
Le maillon manquant : les diagnostics
Aujourd’hui, il est difficile de mesurer l’activité réelle de ces infections dormantes. L’article appelle à développer :
- des tests ultrasensibles pour détecter protéines ou ADN/ARN pathogènes,
- l’analyse du microbiome et de ses déséquilibres,
- le profilage immunitaire pour repérer les signes d’activation chronique.
Conclusion
Le vieillissement ne peut plus être étudié comme un processus purement interne. Les agents pathogènes persistants sont des acteurs majeurs, capables de déclencher ou d’accélérer les caractéristiques du vieillissement.
En les intégrant dans les modèles de longévité, on ouvre la voie à des stratégies combinées : agir à la fois sur nos cellules… et sur les “invités” qui les habitent.